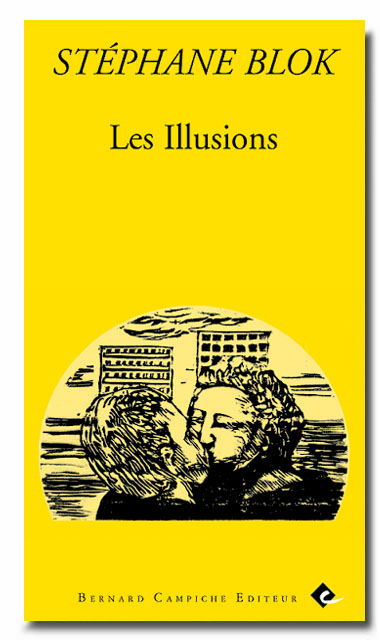Petite anecdote de la semaine. Cela fait un moment que je cours après un certain éditeur qui publie une certaine revue de poésie pour savoir comment me la procurer, parce que ses livres ont l’air magnifiques, et que chez Payot on ne peut pas les commander, et que les banques de notre mouchoir de poche exoeuropéen n’émettent pas de chèques, voyez-vous. Je lui demande surtout la date de sortie du dernier numéro de la revue. On m’ignore, on ne me répond pas, et puis un jour, du tac au tac, on m’écrit : « Cool, c’est l’underground ici. » Ah ouais. Sauf que tu m’envoies un mail et tu me dis bien reçu, je réponds à l’occase. Ou alors tu ne réponds pas, pendant aussi longtemps que tu veux, peut-être même jamais, parce que nous sommes dans un État de droit et que tu ne me dois rien, mais tu ne me dis pas que l’art ne vaut pas la peine qu’on s’y investisse pleinement. Que c’est du bidon, en fait. Je déteste l’élitisme, la coolitude comme institution. J’ai bossé comme éditeur, comme traducteur et comme auteur dans un secteur méga underground de la culture : la SF et le fantastique. Sans doute moins underground que la poésie, soit. J’y connais des gens adorables, très très underground, très très fous, qui ont une passion sincère et flamboyante pour leur art et qui triment comme des galibots de janvier à décembre pour sortir des petites revues de SF que personne ne lit, en maintenant un degré de qualité éditoriale vraiment élevé, et en respectant les délais, juste par amour de l’art, juste parce que c’est important, que c’est sérieux, que c’est vital. Je connais des rédacteurs en chef de minuscules revues de poésie, et aussi des poètes merveilleux, décalés, uniques, immenses, qui m’acceptent en ami sur Facebook et répondent à mes mails avec enthousiasme et humilité. La plupart, en fait. Mais personne ne m’avait jamais encore répondu : « Cool, c’est l’underground ici. » L’élitisme me débecte. Il nous réifie.
Mais ce n’est pas fini. Quelques jours plus tard, la personne finit par répondre à mes questions (parce qu’en dehors de parler de coolitude et de définir ce qui est underground ou non, elle n’avait pas fait grand-chose jusque-là). J’apprends que la revue n’est même pas parue qu’elle est déjà… épuisée ! Que ce titre n’est disponible que pour les abonnés. Que cette dame a d’ailleurs l’intention de supprimer les commandes au numéro et de ne fonctionner qu’avec les abonnements, parce qu’elle préfère « que ça reste confidentiel » et trouve « que ça navigue trop ».
Ces échanges absurdes auront eu le mérite de m’inspirer un long poème en prose, que vous trouverez dans mon dernier billet.